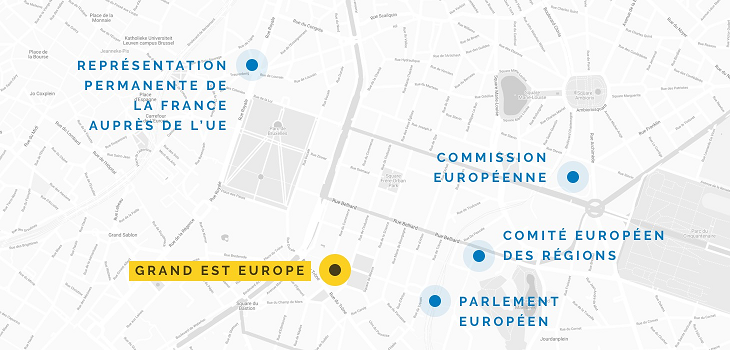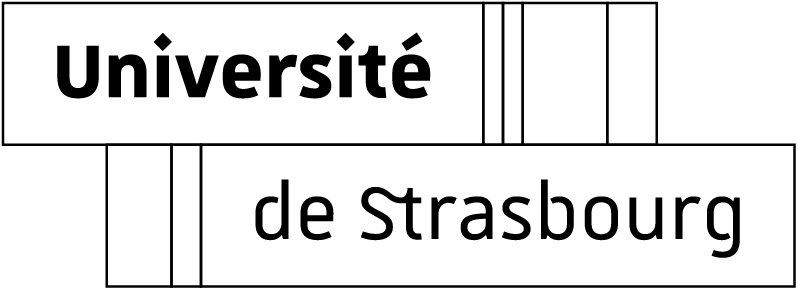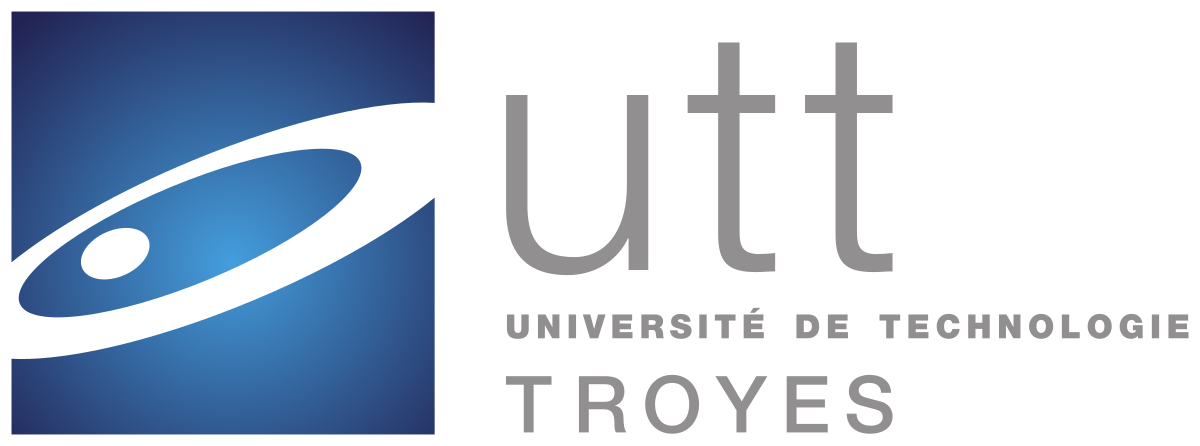Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) : 7 Milliards d’euros pour les infrastructures de transport
Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) : 7 Milliards d’euros pour les infrastructures de transport
Publié par Gaëtan Claeys le vendredi 1 octobre 2021
Mobilités, tourisme et cultureLe Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), doté de 25,8 milliards d’euros pour la période 2021-2027, est le programme européen phare pour cofinancer le développement et le renforcement du Réseau transeuropéen de transport (RTE-T) dans les États membres de l’UE.
Le volet transport de ce programme doit permettre de cofinancer des projets qui renforcent la multimodalité, améliorent les infrastructures, favorisent le développement de l’innovation et des nouvelles technologies sur les neuf corridors du RTE-T.
Le 16 septembre dernier, la Commission européenne a lancé 77 appels à propositions dans le cadre du volet transport du programme MIE, d’une enveloppe globale de 7 milliards d’euros, dont :
- 5,175 milliards d’euros pour:
- Les projets d’infrastructures sur le réseau RTE-T central;
- Les projets d’infrastructures sur le réseau RTE-T global;
- La mobilité intelligente et interopérable: notamment les actions liées au déploiement du système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS) ou encore au déploiement ou à la mise à niveau de l’infrastructure et des services ITS (Systèmes de Transport intelligents) ;
- La mobilité sûre et sécurisée: notamment les actions liées à l’amélioration de la résilience des infrastructures de transport, en particulier face au changement climatique et aux catastrophes naturelles ;
- La mobilité durable et multimodale: notamment les actions visant à renforcer le développement de pôles multimodaux (connexion avec les infrastructures cyclables, accessibilité au personnes à mobilité réduite…).
- 1,575 milliard d’euros pour:
- Un nouveau mécanisme d’infrastructure pour les carburants alternatifs mis en œuvre par le biais d’appels réguliers jusqu’en 2023 pour les actions liées au déploiement de réseaux d’approvisionnement en carburants alternatifs : bornes de recharge électriques et infrastructure hydrogène sur le réseau routier RTE-T… ;
- 330 millions d’euros pour:
Les autorités publiques concernées avec l’accord préalable de leur Etat membre, ainsi que les États membres peuvent soumettre les projets d’ici le 19 janvier 2022 via le portail « funding & tenders« .
Pour plus de détails, retrouvez la journée d’information sur les appels à projet du MIE-T hors carburants alternatifs de la Commission européenne du 27 septembre dernier (ordre du jour et rediffusion).
Une journée d’information (date à venir) sera spécifiquement dédiée en octobre aux appels relatifs aux carburants alternatifs.
Retour au blog Partager : Facebook Twitter
Semaine européenne des régions et des villes
Publié par Adipso le mardi 28 septembre 2021
Mobilités, tourisme et cultureParticipez à la semaine européenne des régions et des villes 2021 :
La 19e édition de la Semaine européenne des régions et de villes aura lieu intégralement en ligne du 11 au 14 octobre.
Organisé par la Commission européenne et le Comité européen des régions, en partenariats avec de nombreuses institutions locales et régionales, la semaine européenne des villes et des régions promeut le débat et la coopération sur la politique régionale en Europe.
Au travers de près de 300 ateliers qui se dérouleront lors de cet événement unique de mise en réseau, d’échange et de valorisation des initiatives locales dans toute l’Europe, seront à l’honneur cette année les thématiques suivantes : cohésion, transition verte, transition numérique, engagement citoyen.
Pour prendre connaissance des événements à venir, retrouvez le Programme de la semaine européenne des régions et des villes.
Les inscriptions aux différents événements clôtureront début octobre.
Retour au blog Partager : Facebook Twitter
Europe Créative : 300 millions d’euros en 2021 pour soutenir une coopération culturelle innovante
Publié par Gaëtan Claeys le mercredi 4 août 2021
Mobilités, tourisme et cultureLe programme de travail 2021 du programme Europe Créative de la Commission européenne alloue un budget d’environ 300 millions d’euros afin de soutenir les professionnels et les artistes de tous les secteurs culturels et créatifs.
En 2021, une vingtaine d’appels à proposition ont été lancés, la plupart avec des dates de clôture comprises entre août et novembre 2021. Tous ces appels à proposition sont consultables sur le portail des offres et financements de la Commission européenne.
Le programme Europe créative est composé de 3 sous-programmes : le volet Culture, le volet Media (audiovisuel et cinéma) et le volet Trans-sectoriel (facilitant la collaboration entre les secteurs).
Les appels à propositions du volet Culture soutiennent spécifiquement :
- Les projets de coopération européenne ;
- Les plateformes européennes pour la promotion des talents émergents ;
- Les réseaux européens des organismes culturels et créatifs ;
- La diffusion des œuvres littéraires européennes ;
- La mobilité des artistes et professionnels de la culture.
Les appels à propositions du volet MEDIA s’articulent autour de quatre pôles :
- Le Cluster Content (contenus), qui encourage la collaboration et l’innovation dans la création d’œuvres audiovisuelles européennes ;
- Le Cluster Business (entreprises), qui vise à promouvoir l’innovation et la compétitivité dans le secteur audiovisuel européen ;
- Le Cluster Audience (publics), qui veut renforcer l’accès et la visibilité des œuvres audiovisuelles ;
- Le Cluster Policy (politiques), qui souhaite promouvoir une approche européenne commune des principales questions de politique audiovisuelle.
Les appels à propositions du volet Trans-sectoriel encouragent quant à eux :
- Les partenariats et collaborations dans le domaine du journalisme ainsi que la promotion d’un environnement médiatique diversifié, indépendant et pluraliste.
- La coopération politique et l’innovation : dans ce domaine, l’appel Innovation Lab est particulièrement novateur. Il cherche à encourager le partage d’expertises le plus large possible en matière de conception et d’essais de solutions numériques innovantes, entre des acteurs diversifiés : entités publiques et privées, des collectivités, des universités, des entreprises de nouvelles technologies et des start ups, ou encore des organisations culturelles, audiovisuelles et créatives. Afin d’accompagner la transformation écologique et numérique des secteurs créatifs et culturels, l’appel Innovation lab actuellement ouvert vise à soutenir le développement d’outils éducatifs innovants pour aborder des sujets sociétaux tels que la désinformation.
Tous les appels à proposition Europe Créative sont ouverts à toutes les organisations actives dans les secteurs culturels et créatifs concernés, y compris les autorités locales et régionales, les entreprises et PME, les universités, les associations et les organisations non gouvernementales. Ils visent donc à financer de nouvelles opportunités avec un programme 2021-2027 qui soutient davantage l’inclusion, à travers une participation plus forte des personnes handicapées, des minorités et personnes issues de milieux défavorisés, ainsi que par la participation de plus d’artistes féminins.
Enfin, le budget total du nouveau programme Europe Créative, représentant 2,4 milliards d’euros sur sept ans, est en hausse de 63 % par rapport au programme 2014-2020 afin de contribuer à la relance du secteur et de soutenir davantage de professionnels du monde de la culture impactés par la pandémie de Covid-19.
Retour au blog Partager : Facebook Twitter
Eurovignette : accord provisoire sur le cadre européen pour les « écotaxes »
Publié par Gaëtan Claeys le mardi 29 juin 2021
Mobilités, tourisme et cultureLe 16 juin, le Conseil de l’UE et le Parlement européen sont parvenus à un accord provisoire sur la révision des règles applicables à la tarification routière en Europe (directive Eurovignette). L’objectif de la directive est de réviser le système de financement des infrastructures routières du réseau transeuropéen de transport (RTE-T). Dans le cadre du Green Deal et en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre dues aux transports, l’objectif est de faire évoluer la tarification routière d’un modèle basé sur la durée à un système fondé sur les kilomètres parcourus, afin d’appliquer le principe de « l’utilisateur-payeur ».
L’accord provisoire étend le champ d’application de certaines règles actuelles et instaure un péage basé sur les émissions de CO2 pour les véhicules lourds dans l’ensemble de l’UE. Les principales nouveautés de la directive sont les suivantes :
- Pour les voitures et camionnettes, les vignettes forfaitaires sur la base de la durée (journée, semaine, mois, année) seront maintenues.
- Pour les poids lourds empruntant le réseau transeuropéen « central », les vignettes forfaitaires sur la base de la durée devront être progressivement supprimées et remplacées par des péages en fonction du nombre de kilomètres parcourus, au plus tard huit ans après l’entrée en vigueur de la directive, avec toutefois des exemptions. Toujours sur le RTE-T central, un système de péage hybride combinant des redevances basées sur la durée et la distance serait également possible.
- La possibilité d’exempter de péage les camions de moins de 12 tonnes sera reconduite pour au maximum 5 ans après l’entrée en vigueur de la directive.
- Afin d’encourager l’utilisation de véhicules moins polluants, les redevances et les péages (distance ou durée) pourront désormais varier en fonction des émissions de CO2 des véhicules (obligation pour les poids lourds, possibilité pour les voitures et camionnettes). En plus du CO2, une redevance pour la pollution de l’air s’appliquera également aux camions (avec des possibilités d’exemption).
Le compromis, dont le texte n’est pas encore disponible, devra encore être adopté par les Etats membres et le Parlement européen, ce qui pourrait se révéler plus difficile que d’habitude pour ce type d’accords interinstitutionnels informels. En effet, plusieurs Etats membres considèrent que l’accord définit trop de règles contraignantes, tandis du côté du Parlement européen la rapporteure chrétienne-démocrate autrichienne Barbara Thaler et les écologistes considèrent que l’accord ne va pas assez loin.
Cet accord provisoire intervient alors qu’il y a actuellement un vif débat sur la tarification routière dans le Grand Est, suite à l’introduction d’une écotaxe en Allemagne et aux réflexions sur l’instauration d’une écotaxe en Alsace en 2024.
Retour au blog Partager : Facebook Twitter
Le nouveau programme européen “Citoyens, égalité, droits et valeurs”
Publié par Gaëtan Claeys le jeudi 3 juin 2021
Mobilités, tourisme et cultureLe nouveau programme européen « Citoyens, égalité, droits et valeurs » 2021-2027 est issu de la fusion des anciens programmes « Droits égalité et citoyenneté », « Europe pour les citoyens » et « Justice ». Il dispose d’un budget presque double de la somme des programmes précédents, soit un budget global d’environ 1,5 milliard d’euros pour la période 2021-2027. Son objectif est de protéger et promouvoir les droits et les valeurs de l’Union et de contribuer au développement de sociétés ouvertes, inclusives, fondées sur le droit, l’égalité et la démocratie.
Le programme est composé de quatre volets :
- « Valeurs de l’Union européenne » (Volet 1)
- « Egalité, droits et égalité des sexes » (Volet 2)
- « Engagement et participation des citoyens » (Volet 3)
- « Daphné », pour lutter contre les violences à l’encontre des femmes, des enfants et des groupes à risque (Volet 4)
Ce programme est conçu pour soutenir la société civile engagée dans la promotion des valeurs de l’Union européenne, en attribuant des subventions d’action ou des subventions de fonctionnement. De premiers appels à projets sont déjà ouverts :
Volet 1, « Valeurs de l’Union Européenne »
- Appel à propositions pour des accords-cadres de partenariat de 4 ans visant à soutenir les réseaux européens, les organisations de la société civile actives au niveau de l’UE et les groupes de réflexion européens dans les domaines des valeurs de l’Union (date limite de candidature le 22 juin 2021)
- Subventions de fonctionnement aux partenaires-cadres actifs dans les domaines des valeurs de l’Union (date limite de candidature le 29 juin 2021)
Volet 2, « Egalité, droits et égalité des sexes »
- Appel à propositions pour promouvoir l’égalité et lutter contre le racisme, la xénophobie et la discrimination (date limite de candidature le 15 juin 2021)
- Appel à propositions pour la protection et la promotion des droits de l’enfant (date limite de candidature le 07 septembre 2021)
- Appel à propositions limité/restreint aux autorités nationales de protection des données sur la sensibilisation des parties prenantes à la législation sur la protection des données (date limite de candidature le 09 septembre 2021)
Volet 3, « Engagement et participation des citoyens »
- Appel à propositions sur la mémoire européenne (date limite de candidature le 22 juin 2021)
Volet 4, « Daphné »
- Appel à propositions pour prévenir et combattre la violence sexiste et la violence contre les enfants (date limite de candidature le 15 juin 2021)
Retour au blog Partager : Facebook Twitter
Europe créative : 2,4 milliards d’euros pour soutenir les secteurs culturels et créatifs
Publié par Gaëtan Claeys le mercredi 2 juin 2021
Mobilités, tourisme et cultureLe programme Europe créative est le programme de l’Union européenne qui soutient les secteurs culturel, créatif et audiovisuel. Il investira dans des actions destinées à préserver et promouvoir la diversité culturelle, artistique et linguistique européenne et le patrimoine culturel de l’Europe, ainsi qu’à contribuer à la compétitivité des secteurs de la culture.
Le programme 2021-2027 sera doté d’un budget total de 2,4 milliards d’euros, soit 63 % de plus par rapport au programme précédent (2014-2020).
Le programme Europe créative est composé de 3 sous-programmes : le volet Culture, le volet Media (audiovisuel et cinéma) et le volet Trans-sectoriel (facilitant la collaboration entre les secteurs). Pour la Commission européenne, ce programme vise à :
- Renforcer la coopération artistique et culturelle à l’échelle européenne ;
- Encourager la coopération en matière d’innovation, de durabilité et de compétitivité ;
- Promouvoir les actions trans-sectorielles innovantes et collaboratives ainsi qu’un environnement médiatique diversifié, indépendant et pluraliste.
La nouvelle édition du programme Europe Créative 2021-2027 a été adoptée par le Parlement européen le 19 mai dernier. Le 27 mai, le programme de travail 2021 du programme Europe créative a été publié par la Commission européenne. Celui-ci allouera un budget d’environ 300 millions d’euros pour aider les professionnels et les artistes de tous les secteurs culturels à travailler en collaboration au niveau européen.
Les premiers appels Europe Créative devraient être publiés début juin sur les trois volets.
Retour au blog Partager : Facebook Twitter
Nouveaux prix Bauhaus européens 2021
Publié par Gaëtan Claeys le mardi 4 mai 2021
Mobilités, tourisme et cultureLa Commission européenne a dévoilé le 23 avril, à l’occasion d’une conférence de haut-niveau dédiée, un premier appel à candidatures pour les prix 2021 du «nouveau Bauhaus européen». L’ambition de cette initiative européenne – conçue comme un laboratoire du design durable, un accélérateur et un réseau – est de favoriser l’émergence de «solutions abordables, inclusives et esthétiques pour répondre aux défis climatiques ». Les prix seront attribués dans dix catégories différentes – autour de ces trois valeurs cardinales – à des projets existants ou de nouvelles idées et de nouveaux concepts qui reflètent les valeurs du « nouveau Bauhaus européen ».
Ces catégories sont : Techniques, matériaux et procédés de construction et de conception ; Construire dans un esprit de circularité ; Solutions pour la coévolution de l’environnement bâti et de la nature ; Des espaces urbains et ruraux régénérés ; Produits et processus liés au mode de vie ; Patrimoine culturel préservé et transformé ; Des lieux de rencontre et de partage réinventés ; Mobilisation de la culture, des arts et des communautés ; Des solutions de vie modulaires, adaptables et mobiles ; Modèles d’éducation interdisciplinaire
Deux récompenses seront attribuées dans chacune des dix catégories, à savoir :
- Le « New European Bauhaus Award » sera consacré à des projets achevés : les lauréats recevront 30 000 € et un soutien à la communication ;
- Le « New European Bauhaus Rising Stars » sera consacré à des concepts ou des projets soumis par de jeunes talents âgés de 30 ans ou moins : les lauréats recevront 15 000 € et un soutien à la communication.
La date limite de candidature sur le site internet dédié est fixée au 31 mai.
Retour au blog Partager : Facebook Twitter
Lancement de l’appel à candidatures de la Capitale européenne du tourisme intelligent 2022
Publié par Gaëtan Claeys le mardi 4 mai 2021
Mobilités, tourisme et cultureLe 22 avril dernier, l’UE a lancé la troisième édition du concours de la Capitale européenne du tourisme intelligent 2022. Cette initiative distingue les villes européennes pour leurs pratiques touristiques exceptionnelles, innovantes et durables. La capitale européenne du tourisme intelligent est une initiative de l’UE, actuellement financée par le programme pour la compétitivité des entreprises et les P.M.E. (programme COSME).
Bouleversées par la pandémie de COVID-19, de nombreuses villes et destinations cherchent désormais à se rétablir et à devenir plus résilientes. Pour concourir pour le titre de Capitale européenne du tourisme intelligent 2022, les villes sont invitées à démontrer leurs pratiques touristiques innovantes dans quatre domaines : accessibilité, durabilité, numérisation, patrimoine culturel et créativité.
Le concours est ouvert aux villes de l’UE, ainsi qu’aux pays non-membres de l’UE qui participent au programme COSME et dont la population est supérieure à 100 000 habitants. L’initiative vise à :
– renforcer le développement innovant généré par le tourisme dans les villes européennes et leurs environs ;
– accroître leur attractivité et renforcer la croissance économique et la création d’emplois ;
– établir un cadre pour l’échange de bonnes pratiques entre les villes participant au concours ;
– créer des opportunités de coopération et de nouveaux partenariats.
Parmi les sept villes qui seront présélectionnées, le jury européen sélectionnera deux lauréats, les Capitales européennes du tourisme intelligent 2022, qui seront dévoilés en novembre 2021. Les deux villes sélectionnées bénéficieront de services en matière de communication et d’image de marque tout au long de l’année 2022.
Les représentants des villes ont jusqu’au 16 juin 2021 à 17h00 pour remplir un formulaire en ligne afin de poser leur candidature.
Retour au blog Partager : Facebook Twitter
Prendre le large avec le Corps européen de solidarité
Publié par Gaëtan Claeys le vendredi 30 avril 2021
Mobilités, tourisme et cultureLe premier appel à propositions pour la période 2021 – 2027 du programme de volontariat, géré par la Commission, vient d’être lancé ce mois-ci.
Depuis sa création en 2016, le Corps européen de solidarité a pour objectif de permettre aux jeunes européens âgés de 17 à 30 ans d’effectuer des missions de volontariat, des stages ou encore des missions professionnelles pour une période de deux à douze mois. Celui-ci vise à promouvoir la solidarité, principalement par l’intermédiaire du volontariat, de faire participer davantage les jeunes et les organisations à des activités de solidarité accessibles et de qualité dans le but de contribuer à renforcer la cohésion, la solidarité, la démocratie et la citoyenneté en Europe, tout en relevant les défis de société.
Les missions peuvent jusqu’à présent être menées dans le pays d’origine du volontaire, dans un autre Etat membre ou encore dans un pays partenaire du programme. Toutefois, cette zone géographique devrait s’élargir à partir de l’année prochaine, permettant ainsi aux jeunes de se porter volontaires dans le cadre d’activités d’aide humanitaire partout dans le monde. Le Corps européen de solidarité met en œuvre quatre actions structurées en deux volets :
- La participation des jeunes aux activités de solidarité : Projets de volontariat ; Équipes de volontaires dans des zones hautement prioritaires ; Projets de solidarité.
- Participation des jeunes à des activités de solidarité liées à l’aide humanitaire (« Volontariat dans le cadre du Corps volontaire européen d’aide humanitaire ») : Projets de volontariat d’aide humanitaire
Le budget alloué au Corps européen de solidarité pour la période 2021 – 2027 représente un peu plus d’un milliard d’euros, dont plus de 138 millions d’euros seront disponibles pour cette année.
Parmi les domaines ciblés par la Commission au sein du programme pour soutenir les grandes priorités politiques de l’Union, il convient de souligner la diversité et l’inclusion sociale, la transition numérique, la transition verte et la promotion de la participation citoyenne des jeunes en Europe. En plus de ces quatre axes d’action et en raison du contexte actuel de crise sanitaire, la priorité en 2021 sera donnée aux projets liés aux domaines de la santé.
La période de candidature pour les projets de volontariat et de solidarité est ouverte jusqu’au 5 octobre. En ce qui concerne la période de candidature pour l’obtention du label de qualité pour le volontariat dans le domaine de l’aide humanitaire, la date limite est fixée au 22 septembre. Les candidatures dans le cadre d’activités de solidarité peuvent être soumises à tout moment.
Les jeunes qui souhaitent participer au programme doivent s’inscrire sur le site officiel du Corps européen de solidarité.
Retour au blog Partager : Facebook Twitter
L’école primaire qui donne l’envie d’Europe aux jeunes
Publié par Gaëtan Claeys le vendredi 30 avril 2021
Mobilités, tourisme et cultureLa Fondation Hippocrène – fondation reconnue d’utilité publique – a pour vocation d’œuvrer en faveur d’une citoyenneté européenne commune par le dialogue et le partage en soutenant la réalisation de projets dans tous les domaines, y compris artistiques. A cette fin, elle organise depuis 2010, le Prix Hippocrène de l’éducation à l’Europe, un concours destiné aux établissements scolaires – écoles primaires, collèges, lycées généraux, lycées professionnels, enseignement agricole – pour distinguer les meilleurs projets de partenariat européen développés par une classe et ses professeurs. Son objectif est de « donner l’envie d’Europe aux jeunes » et récompenser la formation à l’Europe, la mobilité, les échanges, et les projets qui permettent aux jeunes de développer et renforcer un sentiment d’appartenance européenne.
Cette année, l’école maternelle Nord de Sausheim (68) a remporté le prix de la catégorie école primaire pour un projet transfrontalier avec l’Allemagne intitulé « Apprendre la langue et la culture du voisin. S’inscrire progressivement dans une identité européenne ».
Visant à promouvoir, dès le plus jeune âge l’interculturalité, ce projet visait, à travers des échanges avec des élèves allemands, notamment via des outils numériques, à faire découvrir et partager les références culturelles élémentaires des deux côtés du Rhin, notamment les fêtes nationales respectives, l’hymne européen et les recettes de cuisine.
Retrouvez les autres lauréats de l’édition 2021 et plus d’informations sur ce concours sur le site de la fondation Hippocrène
Retour au blog Partager : Facebook Twitter